Michel Rusquet, Trois siècles de musique instrumentale : un parcours découverte : La musique instrumentale de Wolfgang Amadeus Mozart
Les duos avec piano de Wolfgang Amadeus Mozart
Pour cordes seules, Avec piano, Œuvres diverses.
Avec une quarantaine d'œuvres, ce sont de loin les plus nombreuses. Pour l'essentiel, il s'agit de sonates pour violon et piano, un genre que, peu à peu, Mozart a fait évoluer au point d'établir les normes de la sonate pour violon et piano moderne. Il a été le premier à établir un véritable dialogue entre les deux instrumentistes. De plus, il a été l'un des rares compositeurs à résoudre les délicats problèmes sonores posés par l'association d'un violon et d'un instrument à clavier. « La longue série des Sonates pour violon et piano ayant vu le jour depuis l'époque de Mozart et comprenant maints chefs-d'œuvre de Beethoven, Brahms, Franck, Fauré, Debussy, Bloch, Prokofiev, Bartók, pour ne citer que les plus connus, ne contient que peu d'exemples de totale réussite sonore, et certains compositeurs comme Ravel ont choisi de tourner la difficulté en opposant délibérément les deux instruments, accusant ainsi leur inévitable divorce. Cependant, dans ses plus belles sonates, Mozart avait donné la preuve depuis longtemps de ce que les contrastes de timbres pouvaient être harmonisés par la grâce du lyrisme et de la mélodie. »69 Enfin, quitte à bousculer les idées reçues qui nous font accorder plus de poids aux « grandes » sonates des deux siècles suivants, au motif qu'elles s'étalent beaucoup plus dans le discours et la rhétorique, reconnaissons que celles de Mozart, du moins les plus belles du lot, n'ont jamais été surpassées au plan de la poésie et de la pureté musicale. « On ne retrouvera jamais plus après lui ce qu'il a su conférer à ses sonates : l'intensité de l'expression dans la concentration, la litote et la brièveté. »70
Sonates de l'enfance
Conçues comme « Sonates pour clavier avec accompagnement de violon », conformément aux usages de l'époque, ces seize premières sonates se répartissent en trois groupes : d'abord les K 6 à 9, écrites à Paris en janvier 1764 et publiées peu après en tant qu'opus 1 et 2 ; puis les six londoniennes K 10 à 15, terminées à la fin de la même année, publiées avec une dédicace à la reine Charlotte et indiquées avec accompagnement de violon ou flûte, et violoncelle ad libitum ; et enfin les six hollandaises K 26 à 31, écrites en réponse à une commande et achevées à La Haye en février 1766.
Bien sûr, ces œuvres laissent la première place au clavier et le second instrument n'y acquiert un début d'indépendance que très lentement, sans que l'on puisse encore parler d'un véritable dialogue entre les deux partenaires. Malgré ces limites, on ne peut qu'être impressionné par le savoir-faire d'un gamin de huit à dix ans qui, en un temps record, a assimilé diverses influences dont deux le marqueront pour le reste de sa vie créatrice : d'abord celle de Johann Schobert, qu'il connut à Paris et dont la musique, par la place accordée à l'émotion et au sentiment poétique, marqua profondément Wolfgang ; puis celle, mieux connue, de Jean-Chrétien Bach, qu'il fréquenta beaucoup pendant son séjour à Londres. C'est ce dernier dont on retrouve surtout la marque dans les sonates hollandaises, qui sont techniquement les plus avancées. On peut cependant leur préférer les deux séries précédentes qui, dans l'ensemble, ont plus de fraîcheur et de spontanéité, voire d'originalité et de poésie. On pense en particulier à l'Adagio de K 7, dont Leopold disait à juste titre qu'il était « d'un goût tout à fait particulier », à l'Andante (en fa mineur) de K 13, page hautement poétique et étrangement envoûtante par son caractère répétitif, ou plus encore à l'étonnant Andante maestoso (1er mouvement) de K 15, qui offre pour la première fois un dialogue entre les deux instruments et se signale par une sorte de grandeur ainsi que par l'expressivité de ses changements de climat. A vrai dire, c'est dans les six londoniennes, surtout jouées dans la combinaison flûte et pianoforte, que l'amateur curieux trouvera le plus son bonheur, d'autant qu'elles sont comme un merveilleux portrait en musique de l'enfant Mozart tel qu'on nous le décrit souvent, tout à la fois charmant (et charmeur), sensible et affectueux, gai, vif et facétieux.
W. A. Mozart, Sonate en ré majeur K 7.W. A. Mozart,, Sonate en ut majeur K 14 par Jean-Pierre Rampal et Robert Veyron (?).
W. A. Mozart, Sonate en si ♭majeur K 15 par Olivier Baumont, Jean-Christophe Frisch, Antoine Ladrette.
Sonates de l'année 1778 : K 296 et K 301 à 306
Puisque leur authenticité est sérieusement mise en doute, nous passons ici, non sans regret, sur les six sonates « milanaises » K 55 à 60 qui, comme les quatuors du même nom, avaient été attribuées à un Mozart de dix-sept ans, pour nous concentrer sur les sept sonates composées au cours du premier semestre 1778, à Mannheim puis à Paris. Il s'agit des six sonates « palatines » K 301 à 306 et de la K 296 en ut majeur. De par l'indépendance acquise par le violon, ce sont les premières « vraies » sonates pour violon et piano du compositeur. Parmi les sept, cinq se contentent de deux mouvements, selon le modèle de Jean-Chrétien Bach ; leur structure n'en reste pas moins solide et équilibrée.
Composées à Mannheim, les quatre premières « palatines » (K 301 en sol majeur, K 302 en mi♭ majeur, K 303 en ut majeur et K 305 en la majeur) et la K 296 en ut majeur (celle-ci en trois mouvements) révèlent de la part du musicien une sûreté de main et une liberté créatrice tout à fait remarquables. On y sent même une certaine ivresse qu'on peut rapprocher — une fois n'est pas coutume — d'une circonstance précise. Leur composition coïncide en effet « avec la naissance de l'amour violemment passionné de Mozart pour Aloysia Weber. Cet amour n'était pas encore repoussé à l'époque, et les Sonates expriment des sentiments où le bonheur prédomine. Leur langage est intensément mélodique et le violon exploite pleinement son indépendance nouvellement conquise, planant en grandes courbes cantabile. »71 On y relève de nombreux traits qui font penser à l'opéra, et en même temps une palette de sentiments où l'insouciance et l'allégresse font place à la tendresse ou à la mélancolie, comme dans le rondo final (marqué andante grazioso) de K 302 ou plus encore dans le mouvement central (andante sostenuto) de K 296, un vrai chant d'amour, tendre et nostalgique, adressé par Wolfgang à Aloysia juste avant de quitter Mannheim pour Paris. Et cette diversité de climats se double d'une appréciable variété dans la facture, que ce soit dans les procédés utilisés pour donner corps au dialogue entre les deux partenaires ou dans l'architecture même des sonates. Une architecture parfois bien peu conventionnelle, à l'exemple du premier mouvement de K 303 qui s'autorise un plan adagio-molto allegro-adagio-molto allegro.
W. A. Mozart, Sonate en ut majeur K 296 (II. Andante sostenuto) par Szymon Goldberg et Radu Lupu.W. A. Mozart, Sonate en mi♭ majeur, K 302, par Anne Sophie Mutter et Lambert Orkis (enregistrement public à la Philharmonie de Munich).
W.A. Mozart, Sonate en ut majeur, K 303, par Henryk Szeryng et Ingrid Haebler.
Les deux dernières « palatines » (K 304 en mi mineur et K 306 en ré majeur), composées à Paris au printemps 1778, se démarquent nettement des précédentes. En trois vastes mouvements, la K 306 a tout ou presque d'une « grande » sonate de concert, y compris par son côté brillant et virtuose, et privilégie le grand style concertant. On y trouve cependant une certaine gravité, voire de la profondeur, en particulier dans l'ample méditation solitaire de son andante cantabile. Mais, bien que fidèle au plan en deux mouvements, c'est la K 304 en mi mineur qui, par son esprit, tranche le plus par rapport aux sonates de Mannheim. Grave et extrêmement concentrée, c'est une œuvre de pure introversion, sous-tendue de mystérieux sentiments pathétiques qui ne se dissipent que très passagèrement dans le sublime trio en mi majeur du deuxième mouvement. Sommet incontestable de cette floraison de l'année 1778, cette œuvre profondément personnelle semble bien être le reflet de « la solitude malheureuse de Mozart à Paris, dont le public frivole n'accueillait pas ses œuvres d'une manière aussi enthousiaste que celles de l'enfant prodige, douze ans plus tôt. »72
W.A. Mozart, Sonate en mi mineur, K 304, par Kyung-Wha Chung et Kevin Kenner (enregistrement public, Incheon 2011).Sonates des années 1779 à 1782 : K 376 à 380
Pour l'essentiel, il s'agit ici des cinq sonates K 376 à 380, dont l'une (K 378) fut composée au tout début de 1779, au retour de Mozart à Salzbourg, alors que les quatre autres virent le jour à Vienne en 1781, au moment où, fort de son indépendance fraîchement acquise, le musicien se lançait à la conquête du public de la capitale impériale.
Justement populaire, la K 378 en si♭majeur aurait été écrite par Mozart à l'intention de son père et de sa sœur pour marquer sa joie de les retrouver après les lourdes déceptions de son voyage à Paris. C'est en effet une œuvre heureuse, d'une éloquence tranquille et infinîment séduisante, où domine une insouciance teintée de Gemütlichkeit. Particulièrement inspiré, le mouvement médian (andantino sostenuto e cantabile) déroule un chant d'une touchante tendresse qui annonce les confidences des sublimes mouvements lents de concertos à venir.
W. A. Mozart, Sonate en si♭majeur K 378, II. andantino sostenuto e cantabile.Les quatre sonates « viennoises » de 1781, que Mozart allait publier dans un recueil de six sonates comprenant les K 296 et 378, montrent encore de nouvelles avancées sur la voie d'un dialogue à égalité entre les deux instruments. « Lors de leur parution en novembre 1781 […] , elles enthousiasmèrent les contemporains par leur synthèse entre une expression inquiète, capricieuse, voire douloureuse, et un style viennois et respectueux des conventions — mais pas toujours (sonate K 379) — d'un genre destiné aux amateurs plus encore qu'aux connaisseurs. Mozart semble se plier pour conquérir les faveurs de l'élégance viennoise, mais l'originalité et l'expressivité de ses sonates demeurent suffisantes pour frapper son auditoire. Ce fut d'ailleurs la première fois, et sans doute la dernière, que des œuvres instrumentales de Mozart firent l'objet d'une critique aussi unanimement enthousiaste. »73 Seule des quatre à ne comporter aucun mouvement en mineur, la K 376 en fa majeur est aussi la seule à cultiver d'un bout à l'autre une forme de « galanterie » bien en phase avec le goût viennois dominant, mais elle le fait si bien, dans un langage merveilleusement aéré et limpide, qu'on ne peut que céder à son charme. Egalement en fa majeur, la K 377 est d'un tout autre caractère, énergique et presque farouche dans son premier mouvement, qui est suivi d'un magnifique andante à variations en ré mineur où l'art du duo instrumental atteint de nouveaux sommets au service d'un climat profondément mélancolique. La plus originale — et pathétique — est cependant la K 379 en sol majeur : « Son schéma formel est des plus insolites, de même que son plan tonal, un ample mouvement lent adagio en sol majeur, d'un style presque improvisé, malgré la forme sonate, s'enchaînant sans interruption avec un allegro en sol mineur d'une violence accrue par son intense concentration et dont l'énergie, pleine de défi, semble comme un écho de la rupture brutale de Mozart d'avec l'Archevêque. Cette œuvre étrange se termine ensuite sur un paisible andantino cantabile qui retrouve le sol majeur ensoleillé du début et comporte cinq variations… »74 Sans doute la plus brillante du lot, du moins dans son allegro initial, plein d'un sentiment de puissance peu habituel, la K 380 en mi♭majeur marque surtout les esprits par son andante con moto en sol mineur, une page intensément chromatique qui dégage « une poésie étrange, exotique, tendre et mélancolique au point de friser la douleur. »75
W. A. Mozart, Sonate en fa majeur, K 377, I. Allegro, par Oliver Colbentson et Erich Appel.W. A. Mozart, Sonate en fa majeur, K 377,II. Andante, par Itzhak Perlman Daniel Barenboim (?).
W. A. Mozart, Sonate en sol majeur, K 379, II. Allegro, par Anne-Sophie Mutter et Lambert Orkis.
W. A. Mozart, Sonate en mi♭majeur K 380, II. Andante con moto, par Anne Sophie Mutter et Lambert Orkis.
En marge de ces cinq grandes sonates, mentionnons, un peu plus que pour mémoire, celles dont Mozart entreprit la composition en 1781 ou 1782 mais qu'il laissa inachevées : la K 372, qui se limite à un allegro de belle facture(complété et achevé par Stadler) ; la K 402, qui enchaîne un bel andante et une fugue (terminée par Stadler) pour former une sorte de prélude et fugue, et la K 403 (en ut majeur), celle-ci constituée de trois mouvements (dont un andante médian d'une surprenante expressivité, puis un bref Allegretto achevé une fois encore par Stadler). S'y ajoute l'embryon de K 404, qui se limite à deux courts fragments.
Dernières sonates : K 454/481/526/547
Quatre sonates isolées, écrites entre 1784 et 1788, dont une modeste sonatine (la toute dernière) et trois très grandes œuvres. Celles-ci constituent en effet « la glorieuse trilogie qui couronne la production mozartienne dans le domaine qui nous occupe. Par l'ampleur de la conception, l'équilibre idéal et l'individualité des deux partenaires, la richesse et la variété expressive, ces œuvres ne le cèdent à aucune Sonate des successeurs de Mozart, de Beethoven à Bartók. »76
D'avril 1784, la K 454 en si♭majeur fut créée dans un concert public en présence de l'Empereur, lequel dut en sortir ébahi : n'ayant eu le temps d'écrire que la partie de violon, Mozart joua en effet de tête la partie de piano, qui pourtant n'avait rien d'un simple accompagnement mais qu'il avait déjà conçue mentalement de A à Z — comme il en était coutumier — avant de la coucher sur le papier. Belle manifestation de puissance créatrice, pour une œuvre elle-même magistrale, née au milieu d'une superbe floraison de concertos de piano. Conçue dans le grand style « concertant », elle « s'ouvre sur un majestueux prélude lent (largo) dépassant de loin les proportions de l'introduction habituelle […] Un allegro de forme sonate, richement mélodique, s'y enchaîne, morceau dont l'équilibre sonore entre les instruments demeure d'une perfection unique. Mais, ici encore, le cœur même de l'œuvre est atteint avec le sublime andante en mi♭, construit sur trois thèmes, et dont l'atmosphère s'assombrit graduellement, pour atteindre au sommet du pathétique dans le développement central. La réexposition elle-même, d'une passion sans cesse croissante, témoigne des ardentes aspirations de Mozart. Le rondo final, d'une joyeuse atmosphère de fête, quoiqu'avec une légèreté et une délicatesse infinies, offre des surprises et des trésors d'invention sans cesse renouvelés. »77
W. A. Mozart, Sonate en si♭majeur, K 454, II. Andante, par Anne Sophie Mutter et Lambert Orkis.Non moins remarquable, la K 481 en mi♭majeur, achevée en décembre 1785, donne l'impression d'une oeuvre plus austère, plus énigmatique aussi, ne serait-ce que parce qu'elle n'offre pas une opposition de climats aussi tranchée entre mouvements rapides et mouvement lent, et parce qu'on y perçoit une évolution de l'écriture : le dialogue entre les deux instruments perd de son importance pour faire place à un jeu extrêmement subtil dans lequel, à travers un contrepoint lumineux ou des modulations audacieuses, le piano va souvent tenir un rôle directeur. Rien de tel encore dans l'allegro molto initial, concentré, tendu et plein d'énergie, dans le développement duquel Mozart va introduire au violon le fameux motif de quatre notes qui ouvrira le finale de sa symphonie « Jupiter ». En revanche, au début du bouleversant adagio, on croit assister à une scène dans laquelle, avec tendresse et compassion, et ce qu'il faut d'insistance, le piano tend la main au violon pour l'inviter à se libérer et à exprimer sa supplique, qui va bientôt s'élever à travers une mélodie aussi sublime qu'étreignante. Le piano va fraternellement apporter tout son soutien aux effusions de son partenaire, puis, de façon étrangement insinuante, par une succession de modulations surprenantes, le guider vers l'apaisement, avant de s'engager dans le thème varié final (allegretto) où, avec les ressources d'un contrepoint léger et néanmoins solide, il conservera largement un rôle conducteur.
W. A. Mozart, Sonate en mi♭majeur, K 481, II. Adagio, par Szymon Goldberg et Radu Lupu.Aussi belles soient-elles, ces deux grandes sonates K 454 et K 481 n'atteignent pas tout à fait les mêmes cimes que la K 526 en la majeur d'août 1787, terminée dix jours après la célèbre « Petite musique de nuit », alors que Mozart était en train de composer Don Giovanni, car cette ultime grande sonate est à ranger parmi les manifestations supérieures du génie mozartien. « Ce chef-d'oeuvre réalise une synthèse parfaite de la noble polyphonie des Sonates de J.S. Bach et du nouveau style concertant de Mozart lui-même. De ce point de vue, son importance historique est comparable à celle de la grande messe en ut mineur (K 427) de 1783. Jamais Beethoven n'égala la perfection et l'équilibre harmonieux de K 526 ! »78 D'une scintillante vivacité, d'un caractère primesautier non exempt de traits laissant percer nervosité et inquiétude, l'allegro molto initial est éblouissant. Lui succède « un andante en ré, d'une suprême sagesse et d'une sérénité sublime. Son écriture, sévèrement polyphonique, en souligne le détachement altier, d'autant plus émouvant qu'il est l'œuvre d'un jeune homme de trente et un ans. Alfred Einstein écrit : Ce mouvement lent réalise un tel équilibre de l'âme et de l'art, qu'on dirait que Dieu le Père a fait cesser tout mouvement pour une minute d'éternité, afin de permettre à tous les Justes de goûter l'âpre douceur de l'existence. »79 Puis c'est l'exubérance jubilatoire du presto final, sorte de mouvement perpétuel où on « ne sait ce qu'il faut admirer le plus, de l'invention mélodique renouvelée à chaque intermède, ou du contrepoint étourdissant : on n'a pas le temps de dialoguer ici, et c'est le piano qui entraîne son partenaire dans la ronde. »80
W. A. Mozart, Sonate en la majeur, K 526, par Anne Sophie Mutter et Lambert Orkis.Après cela, on a du mal à prendre au sérieux la charmante mais bien modeste « Sonatine » en fa majeur K 547, contemporaine de la sonate dite « facile » pour piano, que Mozart écrivit en juillet 1788, sans doute comme moment de détente au milieu de la composition de ses trois dernières symphonies. Le musicien la présente comme « une petite sonate de piano pour les débutants, avec un violon », ce qui en signale les limites. Cependant, aucun mozartien fervent ne saurait négliger cette petite fleur tardive. « Son andante cantabile d'ouverture (de forme rondo, chose rare pour un premier mouvement) témoigne d'un humour délicieux, et certaines des variations de l'andante final sont du plus pur style tardif de Mozart, par exemple la troisième, aux modulations exquises. Quant à la plus belle, la cinquième en fa mineur, sa rédaction pour piano seul était d'une telle perfection que le compositeur s'avéra incapable de lui adjoindre le moindre accompagnement de violon ! »81
W. A. Mozart, Sonatine en fa majeur k 547, III. Andante, par Rachel Podger et Gary Cooper.Variations pour violon et piano
En marge du vaste catalogue de sonates, Mozart a laissé deux séries de variations qui datent des années 1780 et 1782, toutes deux sur des airs français : les douze variations en sol majeur sur « La Bergère Célimène » K 359 et les six variations en sol mineur sur « Hélas, j'ai perdu mon amant » K 360. Deux œuvres délibérément galantes, d'écoute agréable certes, mais qui n'apportent rien à la gloire du compositeur, celui-ci ayant à l'évidence sacrifié au goût du public de l'époque et obéi à de triviales nécessités alimentaires.
Notes
69. Halbreich Harry, dans François-René Tranchefort (dir.), « Guide de la Musique de chambre », Fayard, Paris 1998, p. 615.
70.Hocquard Jean-Victor, Mozart, de l'ombre à la lumière. Jean-Claude Lattès, Paris 1993, p.136-137.
71. Halbreich Harry, op. cit., p. 617.
72. Ibid., p.618
73. Szersnovicz Patrick, dans «Le Monde de la musique» (248), novembre 2000.
74. Halbreich Harry, op. cit., p. 620.
75. Hocquard Jean-Victor, op. cit., p. 124.
76. Halbreich Harry, op. cit., p. 620.
77. Ibid., p. 621.
78. Ibid., p. 621.
79. Ibid., p. 621-622.
80. Hocquard Jean-Victor, op. cit., p. 33.
81. Halbreich Harry, op. cit., p. 622.
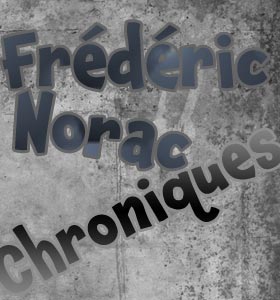
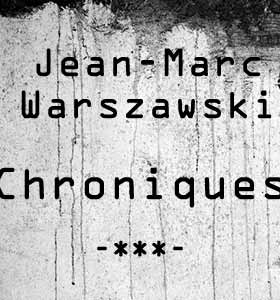
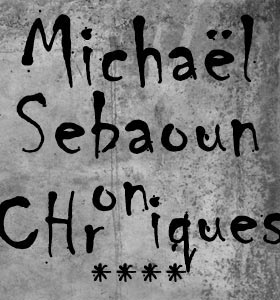
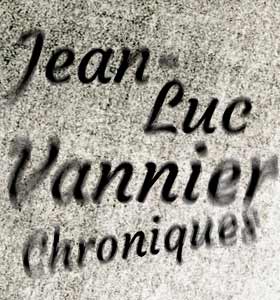

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.
Vendredi 6 Septembre, 2024



