Georges Thill

La Bohème (G. Puccini) Que cette main est froide.
La Tosca (G.Puccini) Le ciel luisait d’étoiles.
Lakmé (Léo Delibes) Fantaisie.
Werther (Massenet) Pourquoi me réveiller.
Carmen (G. Bizet) La fleur que tu m’avais jetée.
Manon ( Massenet) Le rêve de Des Grieux.
Mireille (Ch.Gounod) Anges du Paradis.
Fortunio (A. Messager) La vieille maison grise.
Georges Thill est une des plus typiques incarnations du ténor français. Sa voix douce, péremptoire, héroïque et convaincante se reconnaît entre toutes, dès la première mesure; voix de ténor demi-caractère, capable de suaves incursions dans les emplois plus légers aussi bien que de superbes effusions sous le pourpoint de Raoul de Nangis ou l’armure de Lohengrin. Etonnamment versatile, son timbre, recréant dans Louise le tour spontané du parler parisien, rejoint sans apprêt l’aristocratie des preux chevaliers et des demi-dieux, mais la sympathie chaleureuse demeure la dominante de son génie.
Après un séjour au Conservatoire de Paris, Thill part étudier le chant, en Italie, sous la direction du célèbre ténor Fernando de Lucia, qui avait été autrefois le créateur de Paillasse et restait, à un âge avancé, un vivant exemple du bel-canto. Fort des sortilèges de ce mentor incomparable, la voix de Thill se métamorphose; son stage terminé, maître de soi, il revient en France, où il débute en 1924, à l’Opéra, dans le Nicias de Thaïs. Il chante ensuite le répertoire courant et crée sur cette scène, avec un immense succès, la partie de Calaf dans la production française de l’œuvre inachevée de Puccini : Turandot. Mais il est engagé à Angers pour y jouer ce rôle : Giovanni Zanatello l’entend, et conquis, l’invite pour des galas de Turandot aux arènes de Vérone. Le triomphe franc, définitif, qu’il y remporte le conduit à la Scala de Milan, où il est tour à tour Don José, Paillasse, André Chénier...
Tel fut le point de départ d’une carrière qui devait conférer tant d’honneurs au chant français. Durant les saisons 1931-32, Thill s’impose au Metropolitan Opéra de New-York, dans Aida comme dans Faust, Bornéo et Lakmè. Au Colon de Buenos- Ayres, il ajoute à son répertoire La Fille du Far-West. A Paris, il chante Parsifal, les Huguenots, Guillaume Tell...
Il est devenu le plus coté des chanteurs français et le cinéma l’adopte : Louise, tournée avec Grâce Moore et André Pernet, reste son film le plus notoire. Il convient de noter Rolande et le mauvais garçon d’Henri Rabaud dont il avait personnifié le plus savoureux Marouf. Enfin — apothéose d’une carrière si riche — il est apprécié définitivement dans les ténors wagnériens.
Ce disque microsillon présente le grand artiste dans les pages les plus justement applaudies du répertoire de la Salle Favart.
La Vie de Bohème, « Que cette main est froide » (Puccini)
Dans une mansarde, qu’on est bien à vingt ans !... Rodolphe fait à sa voisine Mimi une déclaration d’amour en règle, lui contant sa vie de poète Cet air que d’illustres interprètes transalpins ont accoutumé de transposer d’un demi-ton est chanté par Thill dans le ton original et sert de tremplin à un magnifique « contre-ut ».
La Tosca, « Le ciel luisait d’étoiles » (Puccini).
Cette version française pare le lamento de Mario Carava- dossi d’un dépouillement et d’une émotion contenue dont la sobriété même touchera le dilettante le plus blasé.
Lakmé, « Fantaisie aux divins mensonges », (Léo Delibesj
Devant les bijoux exotiques de la jeune hindoue qu’il n’a pas encore vue, Gérald se sent saisi d’une émotion prémonitoire... La rêverie de l’officier donne lieu à un air classique, dont les deux strophes symétriques permettent à Georges Thill de faire valoir avec la souplesse de son phrasé d'exquis pianissimi sur les notes terminales.
Werther, « Pourquoi me réveiller » (Massenet)
L’unanimité de la critique a identifié le timbre rare de Thill et la mélancolie du jeune Werther, telle qu’elle s’est trouvée musicalement définie par Massenet.
Carmen, « La fleur que tu m’avais jetée » (Bizet).
Cette romance, d’un sentiment si bouleversant, porte en germe le drame latent qui trouvera plus tard son épilogue devant les arènes de Séville : sans ports de voix désesépérés ni sanglots convulsifs, la Femme et le Pantin sont évoqués ici avec réalisme, sur un fond de sang et de lumière.
Mireille, « Anges du Paradis » (Gounod).
Sur l’esplanade des Saintes-Maries, le gentil Vincent prie de toute sa foi, de tout son amour, le Seigneur, de lui rendre Mireille, perdue dans « La Crau »... Hélas !... elle va mourir, vaincue par le soleil et les... préjugés humains.
Fortunio, « La pauvre vieille maison grise » (Messager)
Evocation en grisaille de jours simples mais heureux ; bijou musical dont la popularité a challengé celle de Jocelyn et de Delmet, et dont l’écriture volontairement confinée dans le médium de la voix donne à Georges Thill l’occasion de conclure ce récital sur une leçon de style et d’articulation.
Louis Cuxac.
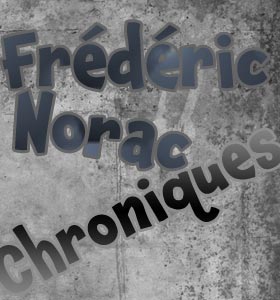
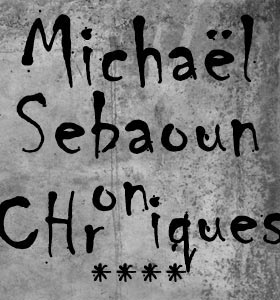
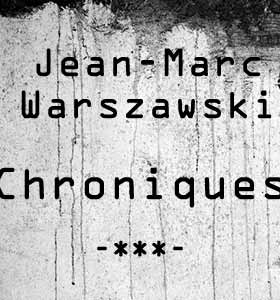
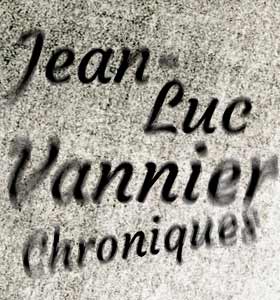
 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.

Lundi 25 Novembre, 2024

