Les (con)figurations formelles du repentir
26-28 mai 2020, Paris
Colloque interdisciplinaire
À la suite du séminaire Textyle (STIH-ENS Ulm) consacré spécifiquement à une étude diachronique de l’épanorthose en littérature, nous avons souhaité étendre nos réflexions sur l’(auto)correction à d’autres domaines d’expression artistiques. Dans cette perspective, la notion de repentir telle qu’elle est issue du vocabulaire des Beaux-Arts nous a semblé opératoire. Envisagé sous l’angle de ses (con)figurations formelles1, le repentir est d’abord à entendre dans le sens de « quelque changement visible qu’un auteur a fait dans son tableau » (Encyclopédie méthodique, Beaux-arts Panckoucke, 1788-1791), ou encore comme la « trace d’une première idée qu’on a voulu corriger » (Dictionnaire de l’Académie, 1798). Plus précisément, le repentir diffère du repeint en ce qu’il s’agit d’une « Correction […] apportée en cours d’exécution » (TLFI), inhérente au processus créatif, tandis que le repeint est une modification postérieure, émanant d’une autre main, surajoutée à une œuvre déjà constituée comme œuvre. C’est ce sens d’autocorrection plus ou moins visible qu’il faut donc privilégier en première instance. Or si le spectre du visible est d’abord réglé par l’intention du créateur qui en fixe les limites, son empan est susceptible d’être réévalué à l’aune des progrès scientifiques qui rendent perceptibles au récepteur les repentirs qu’il n’était pas en mesure d’identifier jusqu’alors. Ainsi la génétique textuelle, les rayons X ou les caméras infrarouges permettent respectivement de déceler et d’interpréter comme repentirs les retouches scripturales et picturales. Pour circonscrire plus précisément encore la notion de repentir, il faut ajouter, à cette extension du domaine du visible, la prise en compte de l’élaboration de l’œuvre au long cours, incluant l’ensemble de ses reprises au fil de ses étapes successives. La catégorie du repentir est ainsi susceptible d’inclure les modifications apportées par Léonard de Vinci à une œuvre au fil d’un cheminement créatif de vingt ans, les retouches de Bonnard sur ses toiles anciennes ou les ratures peintes de Cy Twombly.
Le repentir est donc à envisager comme la trace plus ou moins accessible d’une autocorrection survenant au cours de la campagne de création, plus ou moins longue, d’une œuvre, quel qu’en soit le médium. Ainsi, de même qu’on parle de métaphore in praesentia et in absentia, le repentir peut être envisagé in praesentia ou in absentia, la force tensive entre le rejeté et le rejetant (ou élément de substitution) étant à évaluer à l’aune de cette présence ou de cette absence.
Suggérer que les configurations du repentir peuvent aussi être des figurations invite à conjoindre l’analyse des différents dispositifs, mis en œuvre dans des pratiques textuelles ou artistiques diverses, à un questionnement sur les modalités et les enjeux de l’ostension formelle qui rend ces dispositifs saillants tout en exhibant la fabrique de l’œuvre, que la monstration relève de l’intentio auctoris ou de l’intentio operis.
Si le séminaire précédemment évoqué s’est déjà attaché à l’étude de l’épanorthose, envisagée comme la forme prototypique du repentir verbal, la question n’est pas épuisée pour autant. La figure de l’épanorthose, qui se constitue en diachronie à partir de la correctio sans pourtant y être réductible2, pose des problèmes de classement et de délimitation par rapport aux autres figures de la correction que sont l’anthorisme, la palinodie, mais aussi par rapport à l’hyperbate, à la glose, voire à l’apposition et à la simple énumération quand elle procède davantage par substitution rétroactive que par empilement. Elle fait alors retour sur elle-même, ce retour discursif apparaissant comme une spécification du sens de « retour en arrière », cette autre acception de repentir signalée comme « littéraire » par le TLFI. Le traitement de ces problèmes d’étiquetage et de circonscription de la figure varie en fonction du patron syntaxique et énonciatif (non X mais Y ; X, ou plutôt Y), ainsi que des marqueurs que l’on choisit de privilégier. Il y a donc une « grammaire » de l’épanorthose, qui suppose d’envisager ses rapports avec l’apposition, l’interrogation, la coordination, la ponctuation ainsi qu’une sémantique de l’épanorthose, susceptible de s’attacher aux problématiques de la scalarité, de l’autonymie, des relations au sein du lexique, etc. Il y a enfin une pragmatique de l’épanorthose, à l’œuvre non seulement dans le discours littéraire, mais aussi dans les discours politiques et publicitaires, dans les interactions polies. L’analyse de discours pourrait aussi préciser ses rapports parfois retors à l’éthos ou au pathos, dans des stratégies qui ne sont pas exemptes de feintise ou de duplicité. L’épanorthose se reconfigure aussi comme lapsus signifiant dans le cabinet du psychanalyste. Là où il n’y a rien à voir, ou plutôt à entendre, pour l’auditeur lambda qui ne détecte qu’une erreur non-intentionnelle, le praticien identifie un repentir, qui n’existe que parce qu’il est perçu comme tel, imputable à une infra-intentionnalité.
De fait, les configurations du repentir sont des configurations dynamiques, qui procèdent par révocation ou par recouvrement d’un possible et, comme telles, relèvent d’un travail herméneutique en tuilage ou in progress. Le repentir n’est donc pas seulement une configuration argumentative ; il correspond aussi à un certain mode de construction de la référence, variable selon l’horizon culturel et historique dans lequel il s’inscrit. Le repentir peut ainsi recourir à la stratégie du repoussoir pour mieux désigner le droit chemin moral ou esthétique, dans un contexte où la cartographie des valeurs apparaît comme stabilisée ; mais il peut aussi, à l’inverse, suggérer la multiplicité des voix et des voies, récuser les choix simples dans un univers complexifié où le sens se cherche à tâtons.
Parce que le repentir peut apparaître comme une extrapolation de la « rature représentée » chère à Jacqueline Authier-Revuz, la question des brouillons apparaît comme centrale. Apparaissent donc ici opportunes les études de génétique textuelle interrogeant les modalités formelles des repentirs de l’écrivain tels que les révèle et les donne à penser le dossier génétique d’une œuvre (avant-textes, notes, lettres, etc.). La question des ébauches concerne tout autant les arts que la littérature. Toute étude picturale ou sculpturale s’appuyant sur des carnets de croquis, des dessins, a tout autant de pertinence dans ce colloque qui se veut interdisciplinaire et intersémiotique. La mise en regard des moyens dont dispose chaque art pour penser et figurer le repentir est donc fortement souhaitée.
Si la rétroaction épanorthique inverse l’orientation temporelle d’un discours et instaure une coprésence hiérarchisée et tensionnelle entre deux possibles, dont l’un est plus ou moins révoqué, les repentirs volontairement apparents d’un Picasso introduisent la temporalité – celle induite par le déplacement d’un pied ou d’un objet, ainsi que celle du geste créateur – dans la mimésis. Figure de l’altérité dans l’un, trace de mondes possibles dans l’univers diégétique, le repentir, qu’il soit verbal, pictural, sculptural ou musical, cherche de la sorte à conférer une épaisseur à l’œuvre, une densité nouvelle résultant de l’incorporation, à la création, de la métacréation. On pourra donc interroger les enjeux des configurations formelles du repentir lorsqu’il apparaît comme geste nodal ou moteur de la création. Dans quel(s) but(s) le créateur intègre-t-il à l’œuvre présentée comme achevée ou accomplie une scénographie du repentir ? Est-ce pour mettre à nu les artifices de la création afin d’en dénoncer les ficelles qu’il s’agit de tourner en dérision ? Est-ce pour maintenir vivant ou en suspens un processus créateur en réalité toujours en cours, le repentir apparaissant alors comme un principe vitaliste ? Est-ce qu’inversement le repentir ne dit pas l’angoisse de la fin, lorsque conçu en série, il exprime l’inanité de toute reprise ? Dans cette optique, les notions de variation et de reprise pourront être envisagées comme des formes de repentir – les sérigraphies d’Andy Wharol qui jouent de variantes formelles et chromatiques exemplifient à ce titre un repentir coloré mais morbide qui donne à voir des icônes indéfiniment reproductibles, images de consommation autant que figures exténuées, épuisées par la reprise corrective.
On songera également à des analyses transémiotiques consistant à recourir aux outils d’analyse d’un médium pour mener des investigations dans un autre médium. Certains chercheurs, à l’instar de Dirk Van Hulle avec l’œuvre de Beckett3, recourent ainsi, pour analyser les avant-textes d’une œuvre littéraire, à la notion picturale de pentimenti (du verbe pentirsi, « se repentir ») désignant les altérations picturales visibles qu’une toile a subies et qui témoignent d’un changement d’avis du peintre en cours de création.
Envisageant les (con)figurations formelles du repentir telles qu’elles ont été précédemment présentées, les propositions de communication, de 300 mots, assorties d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 15 décembre à Karine Germoni et Roselyne de Villeneuve :
karine.germoni@sorbonne-universite.fr
roselyne.de_villeneuve@sorbonne-universite.fr
===================
1. Un traitement thématique du repentir entendu au sens moral ou religieux n’est donc pas envisageable dans le cadre d’une réflexion formelle sur la notion.
2. Quoique Lausberg tende à les assimiler dans sa très stimulante notice sur la correctio.
3. « The Pentimenti Principle : The Draft and the Draff in Beckett’s Critique of Narrative Reason”, à paraître dans un des prochains numerous de la revue Samuel Beckett Today/Samuel Beckett aujourd’hui, Amsterdam, Brill-Rodopi.
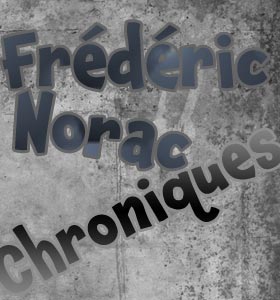
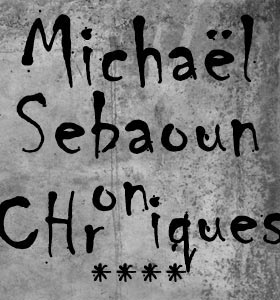
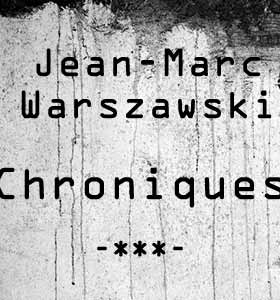
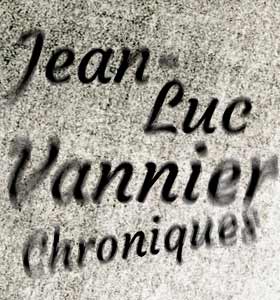
 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.

Mercredi 18 Décembre, 2024

