Dresde, Kulturpalast, 10 mai 2024 — Jean-Marc Warszawski
La 5e de Bruckner par le Concertgebouworkest sous la direction de Klaus Mäkelä : Dresde ne se refuse rien
 Concertgebouworkest. Kulturpalasr Dresden, 10 mai 2024. Photographie © Stephan Floss.
Concertgebouworkest. Kulturpalasr Dresden, 10 mai 2024. Photographie © Stephan Floss.
Ce concert du 10 mai 2024 au Palais de la culture de Dresde, second concert des Dresdner Musikfestspiele, mais concert d’ouverture, celui qui commence par des discours toujours trop longs même quand ils sont courts, fut une soirée musicalement des plus mémorables, en compagnie du Concertgebouworkest sous la direction de Klaus Mäkelä et de la 5e symphonie d'Anton Bruckner.
À sa création, à Graz, en avril 1894, seize après sa composition, deux ans avant la mort du compositeur trop malade pour y assister, sous la direction de Franz Schalk, le premier éditeur qui opéra d’importantes coupures, le monde musicographe d’alors releva bien des défauts à cette œuvre, notamment l’imprécision formelle dont le dessin flou de la forme sonate, sur laquelle les escaladeurs contemporains de partitions ne sont d’ailleurs toujours pas d’accord entre eux. Mais à Berlin, Marcel Remy (1865-1906), journaliste belge, correspondant du journal parisien « Le Temps », aussi fin critique musical, confia ses impressions au périodique, « Le guide musical »1, de Bruxelles, après avoir assisté à une des premières exécutions, la troisième peut-être, dirigée cette fois par Arthur Nikisch.
Il relève la longueur de l’œuvre, la surcharge contrapuntique, le nombre et la variété des thèmes travaillés par la suite de manière inouïe, « l’enchevêtrement [qui] se poursuit sans relâche, avec des trouvailles, des rapprochements imprévus de sonorités et d’harmonies », et le finale qui « échappe à une description. C’est énorme, effrayant de dimensions, de mise en œuvre, de difficultés maîtrisées. » « Tous ces thèmes et mélodies sont des leitmotivs qui ressurgissent ici et là et nous emportent dans une architecture cohérente dans des mouvements monolithiques ». Il ajoute que ce n’est pas une œuvre pour le grand public, « elle a quelque chose d’abstrus, d’énigmatique ». Il remercie Arthur Nikisch pour avoir monté cette œuvre ardue, dont « l’exécution fut excellente sans atteindre la perfection ».
 Klauis Märkelä et le Concertgebouworkest. Kulturpalasr Dresden, 10 mai 2024. Photographie © Stephan Floss.
Klauis Märkelä et le Concertgebouworkest. Kulturpalasr Dresden, 10 mai 2024. Photographie © Stephan Floss.
Il y a déjà, chez ce fin mélomane, en 1898 (il faut lire son article), tout ce qui fait aujourd’hui de cette symphonie le chef-d’œuvre le plus accompli de Bruckner et une pièce majeure du répertoire.
Il entend à raison ici du Johannes Brahms, là, dans ce choral de cuivres du Richard Wagner (une évidence), il aurait pu aussi repérer cette descente de cordes au chromatisme typiquement wagnérien, ou quelques « à-plats » modaux ou en plain-chant, il y entend non pas la forme sonate, mais à juste titre le vieux cadre classique de Haydn et Mozart dans le scherzo… Mais il y manquerait « le coup d’aile de Beethoven ou le torrent mélodique de Wagner ».
Plutôt que de thèmes, nous parlerons de motifs, une généralisation du Leitmotiv, dont nous sentons qu’ils structurent l’œuvre, mais ils sont atomisés par leur nombre et emporté dans la tourmente des complexités contrapuntiques, nous avons du mal à les suivre du premier mouvement au dernier. En effet, cela est frustrant, Bruckner tourne court, s’interdit « le coup d’aile » du développement beethovénien ou le débordement lyrique à la Wagner. Serait-il un froid calculateur comme le pense Marcel Remy ? Nous pensons, au contraire, qu’un sens dramatique aigu guide cette symphonie, avec ses ruptures sèches et coupures de silence. L’absence, il est vrai, de pathos, n’oblitère pas une puissance emphatique souvent soulignée par blocs instrumentaux.
C’est une œuvre assez colossale, dont on a du mal à cerner de quoi sont faits la cohérence, la beauté et le cheminement, tellement elle est peuplée, jusqu’à un coucou de deux notes. Ce n’est pas le contrepoint des anciens organistes de Saxe et de Thuringe, mettant en scène les destinées humaines hasardeuses, tout de même contrôlées par le démiurge (en l’occurrence le compositeur), mais plutôt celui des Lumières de la seconde École de Vienne, où ce sont plutôt les idées qui circulent et concertent entre toutes les voix, qui mettent chez Bruckner des ensembles instrumentaux en mouvement. Il y quelque chose des techniques de musique de chambre adaptées au grand orchestre symphonique.
Le cheminement, prenant parfois le chemin des écoliers, nous mène à l’indescriptible finale, une fugue et forme sonate (avec choral), d’une invraisemblable richesse contrapuntique, tant dans son matériel, venant en partie des mouvements précédents que par sa facture de masse qui fait appel à l’ensemble de l’orchestre dans un déferlement sonore à couper le souffle par sa puissance extatique. Admirable !
Marcel Remy, qui parle de commotion, remercie Arthur Nikisch pour « avoir monté cette œuvre ardue, qui […] n’a eu que peu de succès » et son « exécution était excellente sans atteindre la perfection » qui lui « paraît impossible avec une partition pareille ».
C’est un des points sur lequel nous ne sommes pas d’accord avec ce compte rendu d’il y a cent-vingt-six ans. Le Concertgebouworkest confirme sa réputation d’être un des meilleurs orchestres au monde, Klaus Mäkelä qui en sera bientôt le directeur musical confirme aussi tout le bien qu’on dit de lui et sa passion pour la musique de Bruckner. Ce 10 mai 2024, le Dresdner Kulturpalast était habité de perfection.
 Klaus Mäkelä, Kulturpalast Dresden, 10 mai 2024. Photographie © musicologie.org.
Klaus Mäkelä, Kulturpalast Dresden, 10 mai 2024. Photographie © musicologie.org.
Le Festival de musique de Dresde, sous l’intendance du violoncelliste Jan Vogler s’achèvera le 9 juin avec la philharmonie tchèque sous la direction de Jakub Hrůša dans des œuvres de Bedřich Smetana. Entre-temps on pourra entendre un programme très éclectique : Les saisons de Joseph Haydn, par la Capela Nacional de Catalunya et Le concert des nations sous la direction de Jordi Savall ; Elena Urioste (violon) et Rosi Bergonzi (gamelan) avec le Chinekli Orchestra ; le génial Thomas Quasthoff, qui ne chante plus, mais récite, avec le trio Amatis ; L’ensemble vocal de Saxe dans des œuvres de Bruckner, une « nuit des jeunes talents » ; Raphaela Grome (violoncelle) et Julian Riem (piano) dans des œuvres de compositrices ; du jazz avec l’acteur Charly Hübner et le Resonanz Ensemble ; Pierrot lunaire d’Arnold Schönberg et des pièces de Carl Philipp Emanuel Bach, Béla Bartók, Patricia Kopatchinskaïa, Darius Milhaud, Maurice Ravel ; Anoushka Shankar, digne héritière musicale de son père, avec son ensemble, et le violoncelliste Jan Vogler avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Santtu-Mattias Rouvali.
![]() Jean-Marc Warszawski
Jean-Marc Warszawski
10 mai 2024
Tous ses articles
![]()
![]()
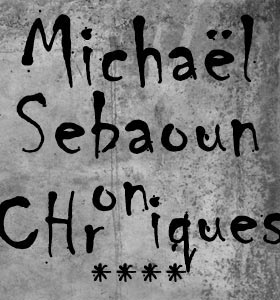
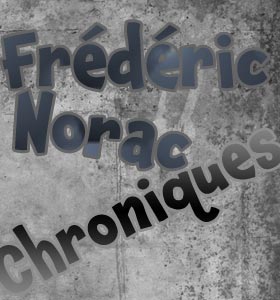
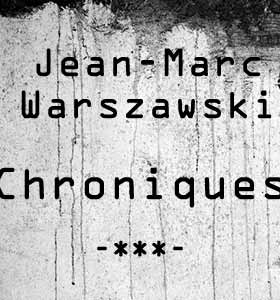
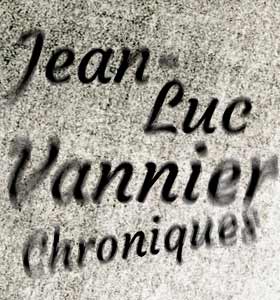
À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41
ISNN 2269-9910.

Dimanche 2 Juin, 2024 14:56

