23 avril 2025 —— Alain Lambert.
Akira Mizubayashi : Âme brisée un roman et une trilogie mélodiques

Akira Mizubayashi, Âme brisée, « Collection Blanche », Gallimard, Paris 2019 ; « Folio » (6941), Gallimard, Paris 2021 [272 pages].
Par le plus grand des hasards (objectifs disaient les surréalistes), je viens de découvrir les romans de l’écrivain japonais de langue française Akira Mizubayashi. Il se trouve que la ville de Caen où j’habite et vis depuis plus d’un demi-siècle fête son millénaire. Et à l’occasion du premier moment de festivité aux premiers jours du printemps, les bibliothécaires de la grande bibliothèque sur le port avaient eu l’idée de mettre en valeur des livres autour de l’idée de millénaire. L’un d’eux, Un amour de mille ans,  n’avait rien à voir avec Caen, sinon le prénom Mathilde d’une des héroïnes. Mais le motif musical indiqué au dos du livre m’a invité à sa lecture faite dans les deux jours suivants.
n’avait rien à voir avec Caen, sinon le prénom Mathilde d’une des héroïnes. Mais le motif musical indiqué au dos du livre m’a invité à sa lecture faite dans les deux jours suivants.
L’histoire d’un étudiant japonais à Paris pour approfondir sa langue « paternelle », comme il la nomme, et découvrant Les noces de Figaro en concert. Et les revoyant à chaque nouvelle séance à cause de Suzanne, dont il s’est entiché. Le personnage autant que la jeune cantatrice, à qui il va écrire quatre longues lettres pour chaque acte, en expliquant tout ce qu’ils lui évoquent.
 Puis j’ai continué avec Âme brisée d’abord, et Une langue venue d’ailleurs, où il décrypte son rapport à la nôtre, celle des Lumières, de Rousseau et de Beaumarchais. Celle qu’il a adoptée pour ne pas rester enfermé dans sa seule langue maternelle.
Puis j’ai continué avec Âme brisée d’abord, et Une langue venue d’ailleurs, où il décrypte son rapport à la nôtre, celle des Lumières, de Rousseau et de Beaumarchais. Celle qu’il a adoptée pour ne pas rester enfermé dans sa seule langue maternelle.
Âme brisée donc, son deuxième roman, pourrait être le titre global de la trilogie dont il est le premier volume, consacré au quatuor à cordes, invention de la musique des Lumières. L’histoire d’un homme à Tokyo, dont le violon a été piétiné par un militaire fanatique japonais, avant de disparaître dans les geôles nippones. Son fils, ayant tout entendu, caché à côté, deviendra luthier et restaurera le violon mutilé à lui rendu alors par un officier, impuissant et désolé. Le livre est construit cette fois sur le quatuor de Schubert Rosamunde dont l’intitulé de chaque mouvement constitue chacun des quatre chapitres du livre, débuté par un Recueillement, et clos par un Epilogue. L’histoire donc d’une résurrection, celle d’un instrument, qui permet le retour à la mémoire du père, mais aussi de l’homme qui lui a remis le violon brisé. Cet homme qu’un régime autoritaire a obligé à devenir militaire et « a commis des atrocités » dont il ne dit rien, mais qu’il a essayé d’oublier, une fois redevenu civil, grâce à la musique consolatrice, pour reprendre la formule de Georges Duhamel qui date de cette même période. Voilà le portrait qu’en donne sa petite fille violoniste et concertiste, lors de la rencontre avec le luthier toujours en quête de son passé perdu :
« Ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était quand même les quatuors à cordes. En particulier ceux de Mozart, Beethoven et Schubert… Je me souviens de ce qu’il m’a dit un jour : « C’est l’exact contraire de ce que je déteste le plus : la musique militaire. » — La musique de l’armée ? — Oui. La musique qui servait à transformer les soldats en têtes de bétail comme il disait. La musique militaire qu’il ne pouvait pas ne pas entendre dans l’armée était pour lui le dévoiement de la musique. Au lieu d’être le lieu d’une expérience personnelle intérieure, la musique militaire enlevait à l’homme son essence individuelle. Ce sont ses propres mots… Il abhorrait la musique militaire. Je crois qu’il avait besoin de s’immerger dans la musique pour effacer en lui toutes les traces de la musique dépravée. […] Il avait des rapports extrêmement intenses avec la musique. C’était quelque chose d’absolument indispensable à l’équilibre de son psychisme… qui a été singulièrement fragilisé par la guerre. Il ne m’a jamais parlé de sa vie de militaire, de ce qu’il avait vécu dans l’armée, sauf une fois. De la folie collective que la musique militaire exaltait à outrance, il n’avait gardé qu’un souvenir cauchemardesque, je crois… […] Il m’a donc dit une fois, une seule fois… c’était tellement exceptionnel que ça m’est resté. Il m’a parlé comme à un absent ou comme s’il se parlait à lui-même : « On a commis des atrocités… Tous les actes, même les plus barbares, les plus inhumains, se justifiaient ; au nom du l’empereur… Plus jamais ça, plus jamais. J’ai honte d’avoir été lieutenant de l’armée de terre… J’ai honte d’avoir survécu ». Après cet aveu brusque et inattendu, il a sombré dans un état d’absence méditative… [p 141-142 dans l’édition Gallimard de 2019].
 Le suivant, Reine de cœur, paru en 2022 chez le même éditeur, nous en dit un peu plus sur les atrocités de l’impérialisme japonais en Chine, à travers le personnage d’un jeune altiste venu en France au Conservatoire de Paris, mais reparti dans son pays à cause de la guerre mondiale. Il ne connaîtra pas son enfant à naître, dont la petite fille, devenue altiste à son tour, va en redécouvrir l’histoire, et le faire revivre grâce à des lettres et un carnet retrouvé. Par la musique aussi. Ici l’œuvre structurant les chapitres du livre est les cinq mouvements de la 8e symphonie de Chostakovitch dont l’écrivain mélomane et musicien donne sa lecture poétique à la fin du livre.
Le suivant, Reine de cœur, paru en 2022 chez le même éditeur, nous en dit un peu plus sur les atrocités de l’impérialisme japonais en Chine, à travers le personnage d’un jeune altiste venu en France au Conservatoire de Paris, mais reparti dans son pays à cause de la guerre mondiale. Il ne connaîtra pas son enfant à naître, dont la petite fille, devenue altiste à son tour, va en redécouvrir l’histoire, et le faire revivre grâce à des lettres et un carnet retrouvé. Par la musique aussi. Ici l’œuvre structurant les chapitres du livre est les cinq mouvements de la 8e symphonie de Chostakovitch dont l’écrivain mélomane et musicien donne sa lecture poétique à la fin du livre.
 Le troisième opus, Suite inoubliable, paru en 2023, dédié au violoncelle, nous fait recroiser des personnages des deux précédents, surtout le luthier du premier, qui accueille comme assistante une jeune consœur, dont le grand-père japonais, jeune violoncelliste prodige, a disparu en 1945, à peine incorporé à son régiment. Mais son violoncelle, prêté par une fondation suisse, arrive, toujours par le jeu du hasard objectif, dans son atelier. Et de nouveau la musique, fille d’Orphée, permet de retrouver des souvenirs enfouis et de faire revivre des êtres morts et oubliés depuis des décennies. Ici l’œuvre structurant les chapitres est la Première suite pour violoncelle de Bach, bien évidemment. Une superbe trilogie musicale quasi quadriphonique si on y ajoute celui dédié aux Noces.
Le troisième opus, Suite inoubliable, paru en 2023, dédié au violoncelle, nous fait recroiser des personnages des deux précédents, surtout le luthier du premier, qui accueille comme assistante une jeune consœur, dont le grand-père japonais, jeune violoncelliste prodige, a disparu en 1945, à peine incorporé à son régiment. Mais son violoncelle, prêté par une fondation suisse, arrive, toujours par le jeu du hasard objectif, dans son atelier. Et de nouveau la musique, fille d’Orphée, permet de retrouver des souvenirs enfouis et de faire revivre des êtres morts et oubliés depuis des décennies. Ici l’œuvre structurant les chapitres est la Première suite pour violoncelle de Bach, bien évidemment. Une superbe trilogie musicale quasi quadriphonique si on y ajoute celui dédié aux Noces.
Je reviens sur l’extrait d’Âme brisée retranscrit un peu plus haut, car l’auteur y fait bien la distinction entre musique dépravée ou dévoyée et musique consolatrice ou restaurative, dont chaque roman est un exemple. J’ai pour ma part commencé à collaborer à Musicologie.org en janvier 2005, il y a tout juste 20 ans, en envoyant un long article réécrivant mon mémoire de maîtrise de philosophie sur Rousseau et la musique [voir cet article]. Suivi en mars par un autre plus épidermique où j’essayais de montrer en quoi les passages éponymes de La haine de la musique de Pascal Quignard reposaient sur une série de contre sens, glissements sémantiques et généralisations abusives [voir notre chronique] envers toute musique, rendue responsable de collaboration au génocide juif, alors qu’il ne parlait que de son utilisation perverse, ou de la musique militaire. Effaçant justement les deux côtés de la musique qu’Akira Misubayashi souligne lui aussi, et que j’ai essayé de développer à plusieurs reprises sur ce site, en continuant de relire Rousseau moi aussi.
23 avril 2025![]() Alain Lambert
Alain Lambert
2025
© musicologie.org
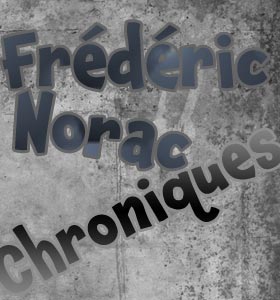
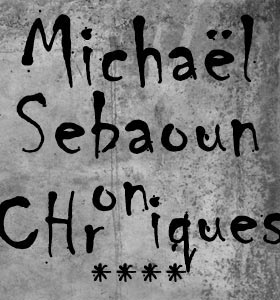
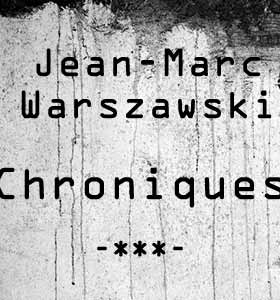
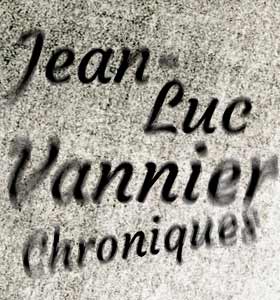
 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.

Mercredi 23 Avril, 2025 3:59

