La Gigue

Gigue (allemand : Geige = violon ; giguer en vieux français = gambader ; relation au va-et-vient de l'archet ?)
Mais aussi : 1. De gig(ot) ; de l’ancien français gigue, genre d’instrument à cordes ; 2. de l’anglais jig, genre de danse vive.
Signifie aussi / 1. cuisse de chevreuil (vieux), jambe (familier) ; fille maigre : « une grande gigue » (familier).
Danse, genre musical
Le mot attesté en 1150 et par quelques auteurs du xiiie siècle, dont Jean de Garlande (v. 1190, ap. 1252) et plus tard Dante, désigne un instrument à archet, peut-être une petite vièle.
La danse elle-même, populaire, est attestée au xve siècle en Écosse, en Angleterre (jig, gigg, gigge), puis dans l'ensemble des îles britanniques au siècle suivant, où ces danses apparaissent dans des recueils de musique, sont dansées dans les intermèdes des comédies et à la cour anglaise à l'époque élisabéthaine.
Gigue irlandaise baroque, arrangement pour orchestre baroque par Claude Nadeau et Mmignoned, d'après Alan Stivell, Hélène Checco (violon), Elisabeth Allain (contrebasse), Symphonie de Breizh, sous la direction deClaude Nadeau, Ar mor barok, pirates et corsaires au xviiie siècle, avec Serj Plénier (baryton et récitant) 24 mai 2011, Vannes.Elle est également dansée par des troupes de théâtre itinérantes, et selon plusieurs témoignages, aurait des caractères impudiques, voire obscènes.
Au début du xviie siècle, elle gagne le continent, a du succès en France dans la seconde moitié du siècle grâce à Jacques Gautier, luthiste français à la cour d'Angleterre. Elle est alors dansée à la cour, on y apprécie sa vivacité qui requiert « sauts, cabrioles, pirouettes ». Elle se danse en couple ou seul. Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, André Campra ont composé des gigues célèbres.
Jean-Philippe Rameau, Suite en mi mineur, Gigue en rondeau, Marcelle Meyer (piano).André Campra, « Gigue », extraite de l'opéra Tancrède, Ensemble instrumental de Provence, ensemble vocal d'Avignon, Clément Zaffini, Georges Durand, Jacques Bona, Catherine Dussaut, Armand Arapian.
Ce terme désigne en fait plusieurs types de danses, de rythme binaire ou ternaire, qui sont caractérisées par des sauts énergiques et des frappes des talons ou des pointes, voire les deux alternées.
Elle intègre les suites de la musique savante, notamment la suite allemande (allemande, courante, sarabande, gigue), ou sur le même modèle, les suites anglaises et françaises de Johann Sebastian Bach.
Johann Sebastian Bach, Suite française no 6, en mi majeur, BWV 817, Gigue, Ingrid Haebler (pinao).Importée États-Unis d'Amérique par les colons au xviie siècle, elle y est récupérée par les esclaves noirs qui en font une danse syncopée, elle sera à son tour en usage chez les minstrels. Elle a un immense succès au cours du xixe siècle (il y a des danseurs de gigue célèbres), elle est à l'origine des claquettes.
Au xixe siècle, de nombreuses gigues pour le piano, destinées au salon sont éditées.
Gigue irlandaise, par Peak Fiddler (violon).La Gigue (bal musette), par Gérard Lamolère.
 Tablature de gigue par Denis Gaultier, 1670.
Tablature de gigue par Denis Gaultier, 1670.


 La gigue. Gustave Doré, 1855.
La gigue. Gustave Doré, 1855.

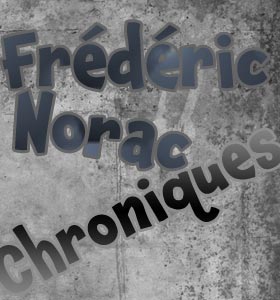
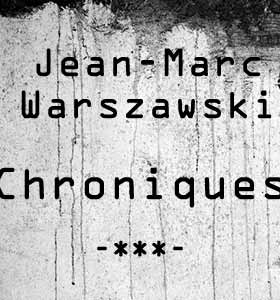
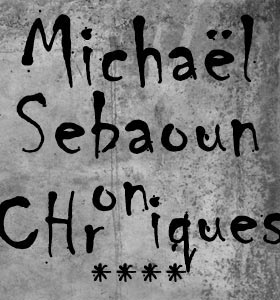
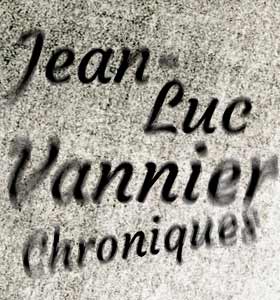
 À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.
Samedi 5 Avril, 2025


